
J’ai eu envie de découvrir ce livre après le passage de Cyril Dion dans l’émission la grande librairie du 27 octobre 2021. Je l’ai emprunté à la bibliothèque et je l’ai dévoré en une après-midi (ce qui n’est pas un mince exploit étant donné que je suis interrompue toutes les 10 min environ…).
En faire un résumé serait le réduire à un simple témoignage et cela va bien au-delà, mais si je devais en dresser les grandes lignes, il s’agit du récit d’une anthropologue française en mission dans la région montagneuse du Kamchatka situées dans l’extrême orient russe. La jeune femme se fait attaquer par une ourse et en réchappe défigurée.
Comme aux temps du mythe, c’est l’indistinction qui règne, je suis cette forme incertaine aux traits disparus sous les brèches ouvertes du visage, recouverte d’humeurs et de sang : c’est une naissance, puisque ce n’est manifestement pas une mort (p.13)
Les premières ligne annoncent la couleur ! Rouge sang.
A mesure qu’il s’éloigne et que je rentre en moi-même nous nous ressaisissons de nous-même. Lui sans moi, moi sans lui, arriver à survivre malgré ce qui a été perdu dans le corps de l’autre ; arriver à vivre avec ce qui y a été déposé (p.14).
Selon son ami Andreï, l’ours n’a pas voulu la tuer, mais la marquer, faisant d’elle une miedka (moité humaine moitié ours).
Il y a 1000 choses que j’ai aimé dans ce récit brut et puissant. Nastassja est confrontée à la violence de l’altérité sous différente forme : violence de l’attaque, violence du monde hospitalier, violences relationnelles.
J’ai trouvé le récit de sa prise en charge hospitalière particulièrement glaçante. En tant que soignante, cela permet de s’interroger sur son propre positionnement, sur les choses que l’on ne questionne plus. La violence institutionnelle se répercute jusque dans sa prise en charge. Sa rencontre avec la psychologue hospitalière m’a également interrogée. Je me dis que c’est toujours mieux de privilégier le « ne pas nuire au patient » plutôt qu’avoir l’air intelligente en faisant une interprétation sauvage…
J’ai aimé la vision qu’elle propose de l’enfance dans laquelle je me suis retrouvée.
« Je crois qu’enfants nous héritons des territoires qu’il nous faudra conquérir tout au long de notre vie. Petite, je voulais vivre parce qu’il y avait les fauves, les chevaux et l’appel de la forêt ; les grandes étendues, les hautes montagnes et la mer déchainée ; les acrobates, les funambules et les conteurs d’histoire. L’antivie se résumait à la salle de classe, aux mathématiques et à la ville. Heureusement, à lâge adulte, j’ai rencontré l’anthropologie. p.86.
Et si nous nous interrogions sur le territoire que nous aimerions conquérir ?
« L’enfant possède une chose que l’adulte cherche désesperement tout au long de son existence : un refuge. Ce sont les parois de l’utérus avec tous les nutriments affluant quotidiennement qu’il faut parfois arriver à reconstuire autour de soi p.106
Après sa prise en charge médicale, Nastassja a besoin de retourner sur les lieux du crime pour se reconstruire aurait-on pu dire, mais il me semble que c’est quelque chose d’autre que je ne saurai pas nommer. Elle dit cette phrase folle, que l’ours l’a mordu la mâchoire pour lui rendre la parole.
« Voilà notre situation actuelle, à l’ours et à moi. Être devenu un point focal dont tout le monde parle mais que personne ne saisit. C’est précisément pour cette raison que je ne cesse de trébucher sur des interprétations réductrices voire triviales, si aimante soient-elles : parce que nous sommes face à un vide sémantique, à un hors-champ, qui concerne tous les collectifs et qui fait peur. D’où l’empressement des uns et des autres pour coller des étiquettes, pour définir, délimiter, donner une forme à l’événement. Ne pas laisser planer l’incertitude à son sujet, c’est le normaliser pour le faire entrer coûte que coûte dans le collectif humain. Et pourtant. L’ours et moi parlons de liminarité, et même si c’est terrifiant, personne n’y changera rien.
Elle partage tout au long du récit sa vision si singulière d’être au monde.
Les arbres, les animaux, les rivières, chaque partie du monde retient tout ce que l’on fait et tout ce que l’on dit, et même parfois, ce que l’on rêve et ce que l’on pense. C’est pour ça qu’il faut faire très attention aux pensées que nous formulons, puisque le monde n’oublie rien, et que chacun des éléments qui le composent voit, entend, sait. Ce qui s’est passé, ce qui advient, ce qui se prépare. Il existe un qui-vive des êtres extérieurs aux hommes, toujours prêts à déborder leurs attentes. Aussi chaque forme-pensée que nous déposons hors de nous-même vient se mêler et s’ajouter aux anciennes histoires qui informent l’environnement, ainsi qu’aux dispositions quie le peuplent. p.114
Je me dis que si l’on va jusqu’au bout de cette vision, nos sociétés urbaines sont certainement malades de cette saturation de forme-pensée. On pourrait certainement m’interpeller à juste titre sur cette interprétation romantique de la nature que j’en fais. Pourtant, son récit est tout sauf une vision idéalisée de la mère-nature, qui lui a couté la moitié de son visage. Un ours, ce n’est pas Baloo ou Winnie l’ourson.
Enfin j’ai aimé cette tentative de reconnexion à extrêmement de cette femme à cet environnement hostile. J’ai aimé ce récit profondément sensoriel. Moi aussi j’ai eu envie d’aller dans sa tente à la lumière tamisée, la chaleur du feu, la contenance des peaux d’animaux. J’ai apprécié que cela ne tombe pas dans le voyeurisme. C’est remarquablement bien écrit et d’une grande justesse. Ce n’est pas une lecture dont on sort indemne. C’est une vraie expérience de lecture.
J’admets qu’il y a bien un sens au monde dans lequel nous vivons. Un rythme. Une orientation. D’est en ouest. De l’hivers au printemps. De l’aube à la nuit. De la source à la mer. De l’utérus à la lumière. […] Je dis qu’il y a quelque chose d’invisible, qui pousse nos vies vers l’inattendu.

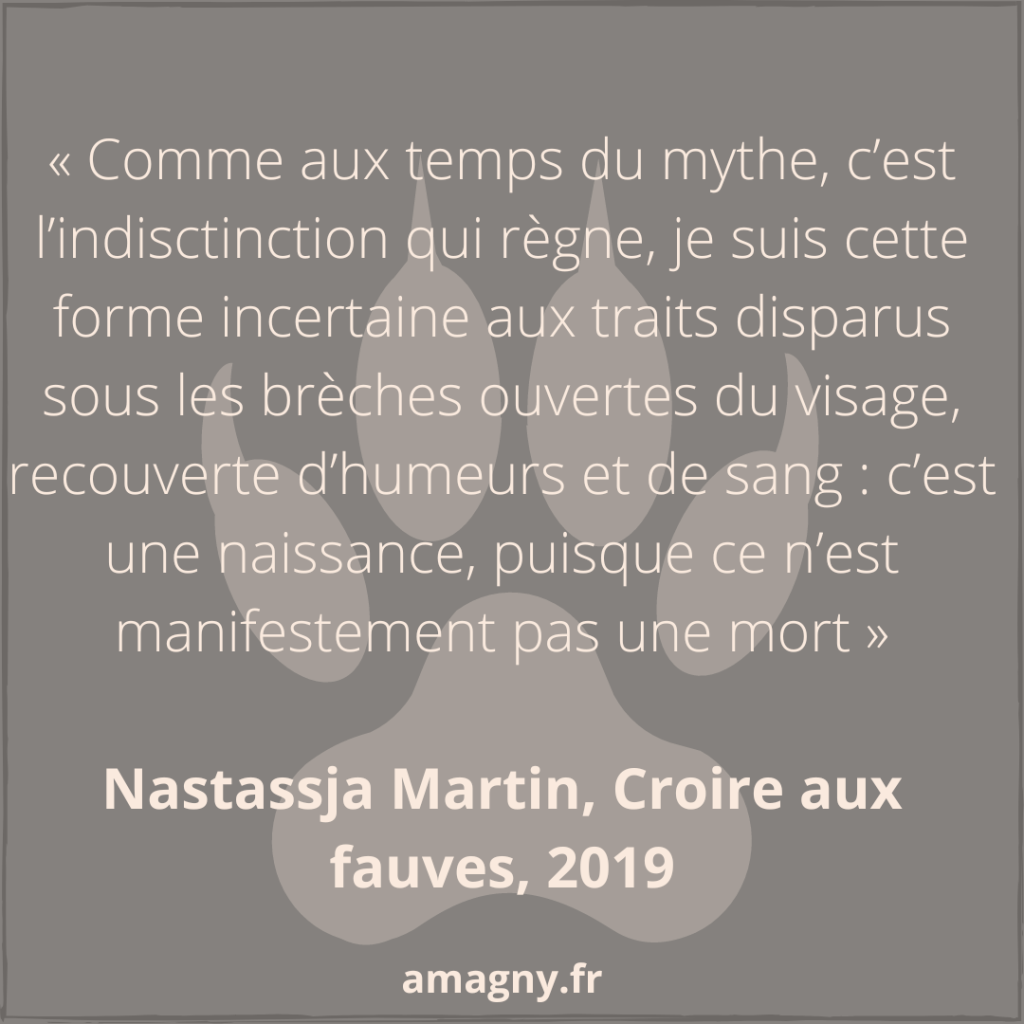

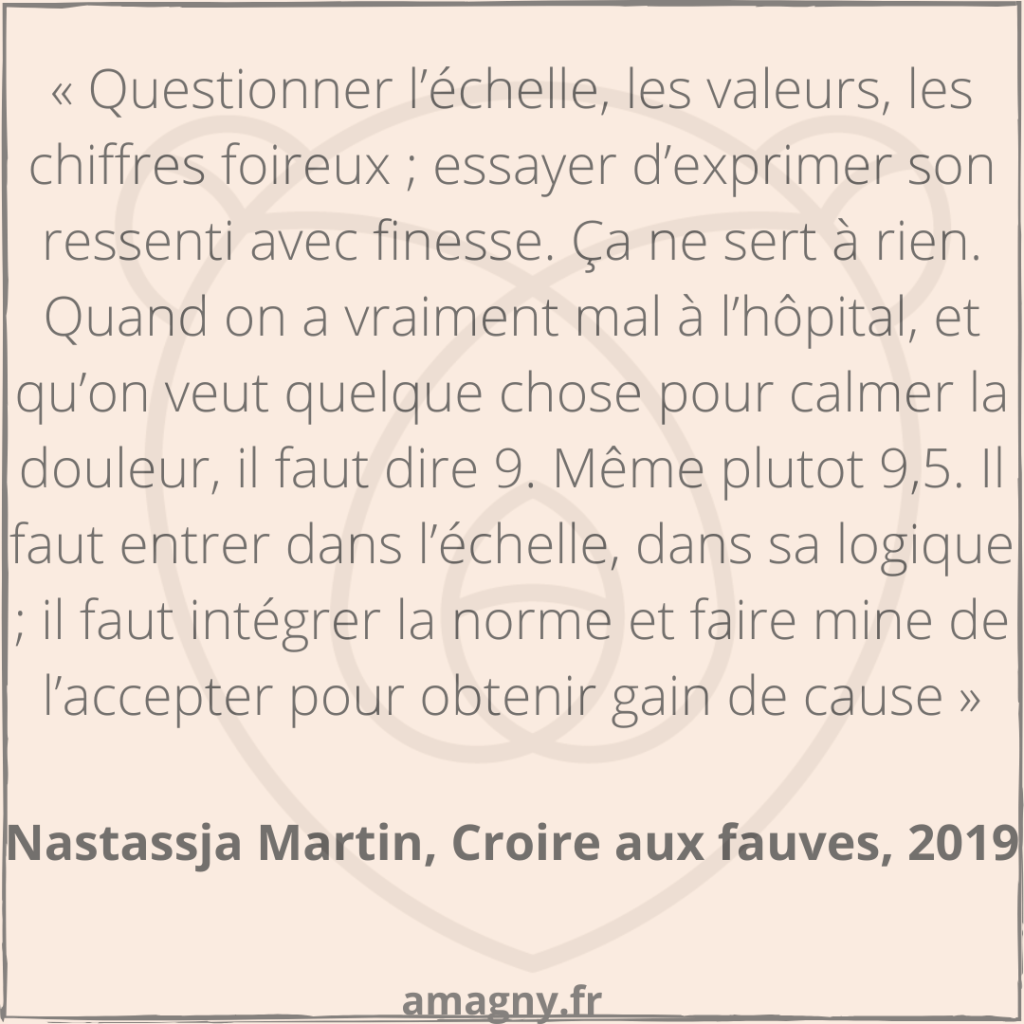
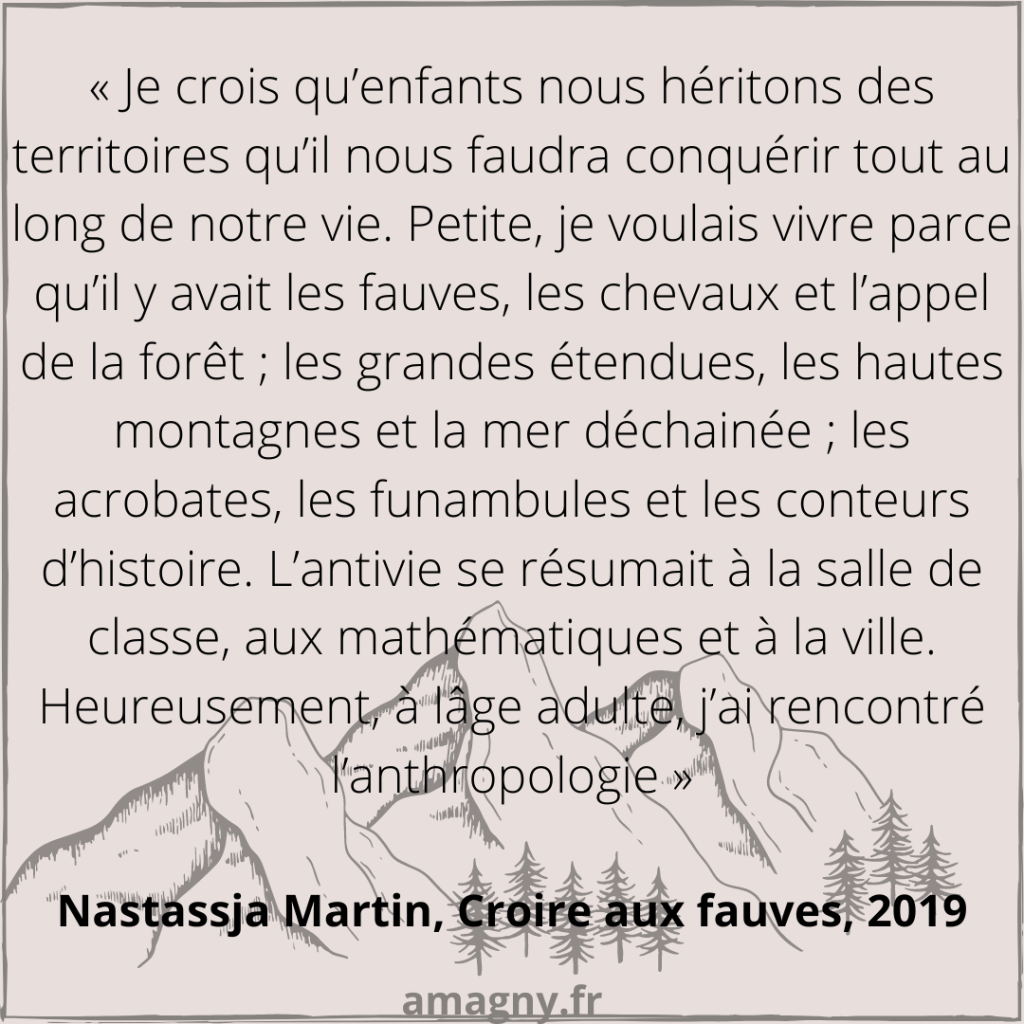
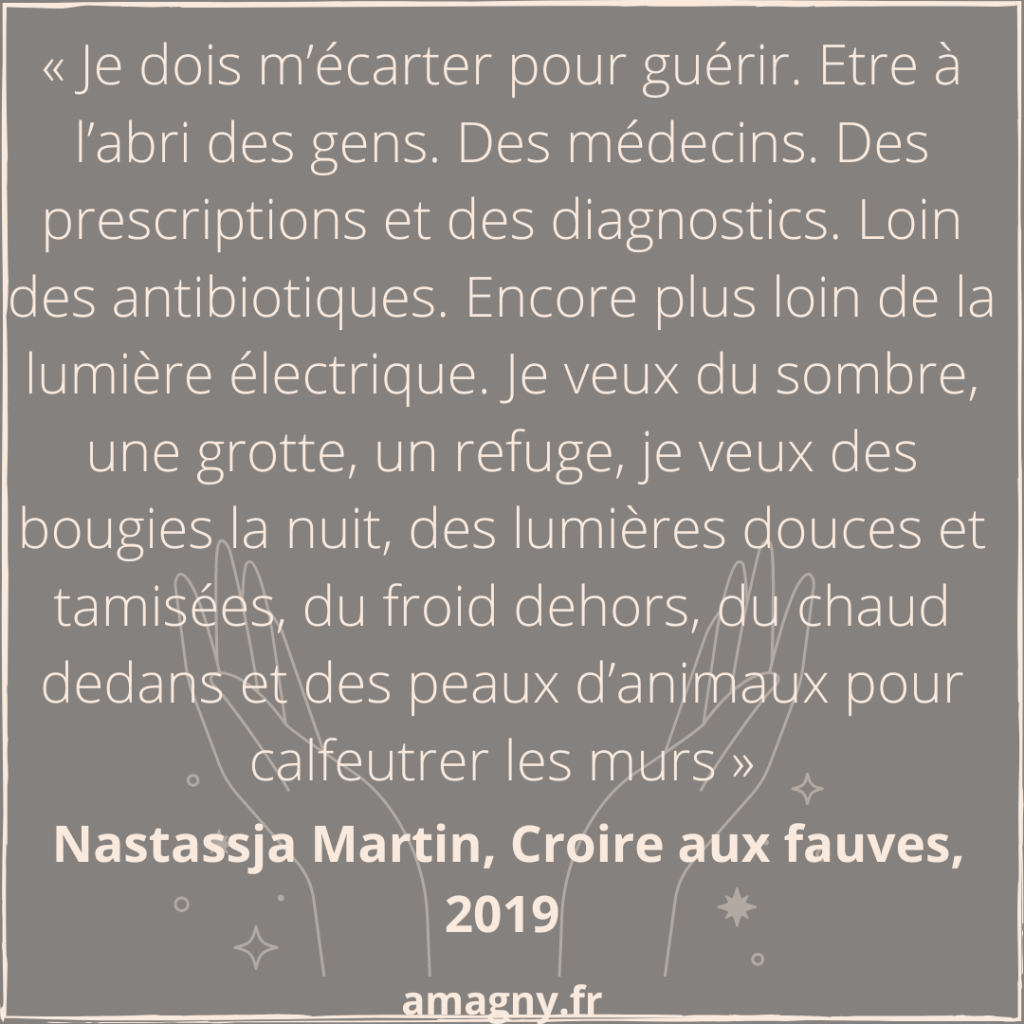
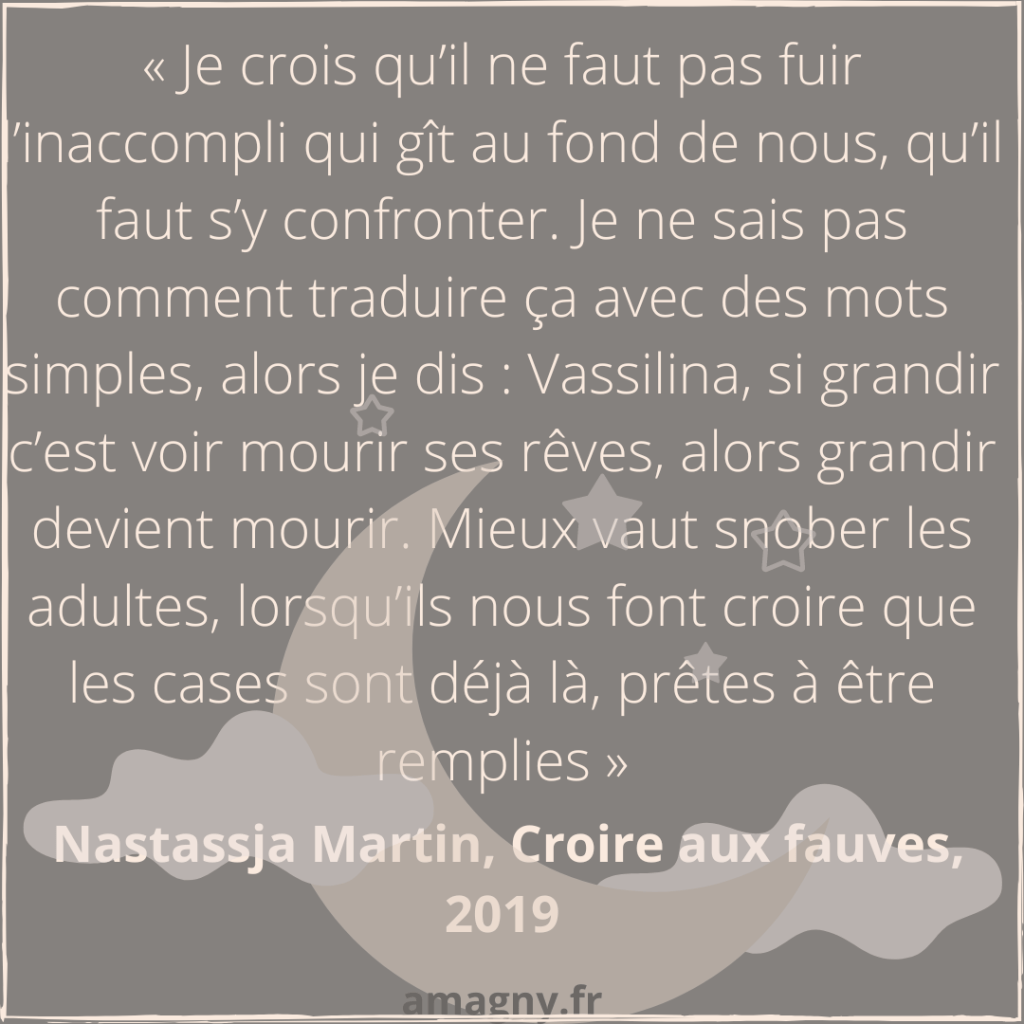
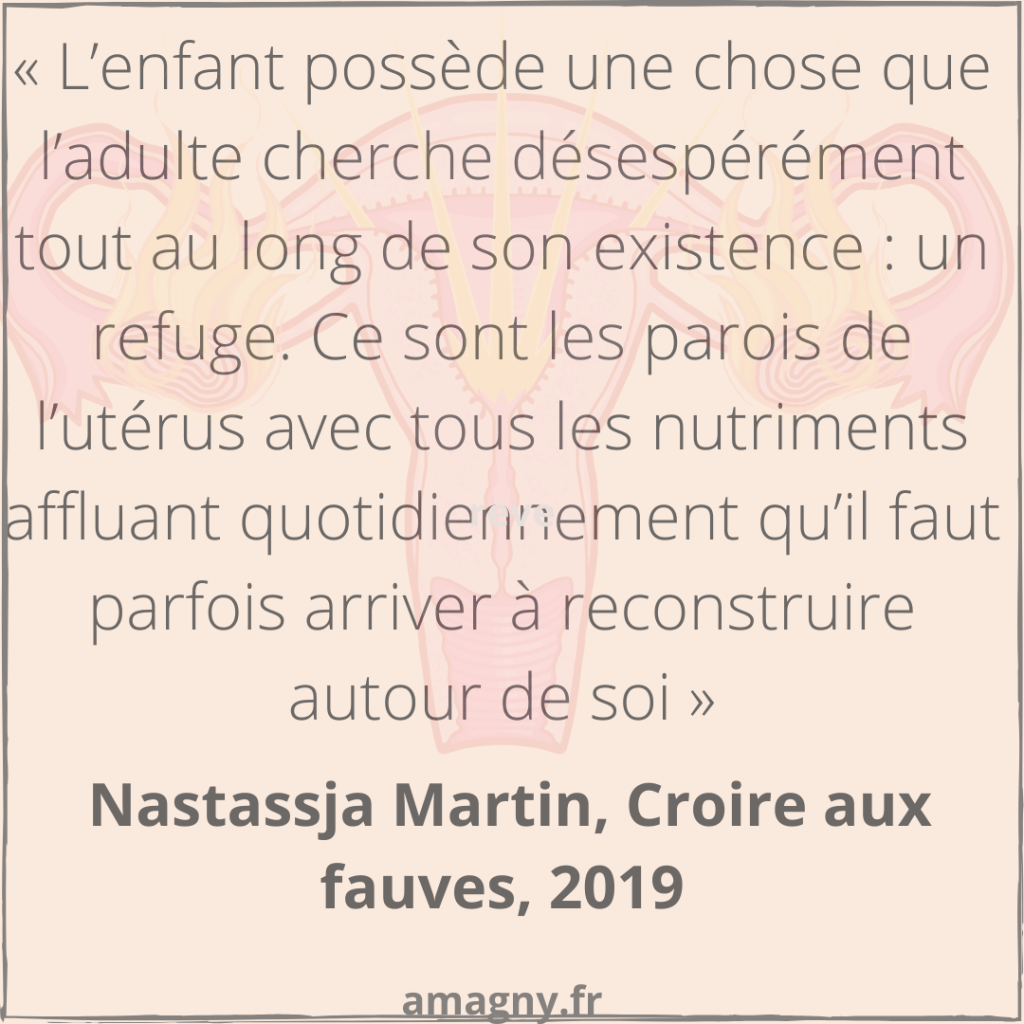
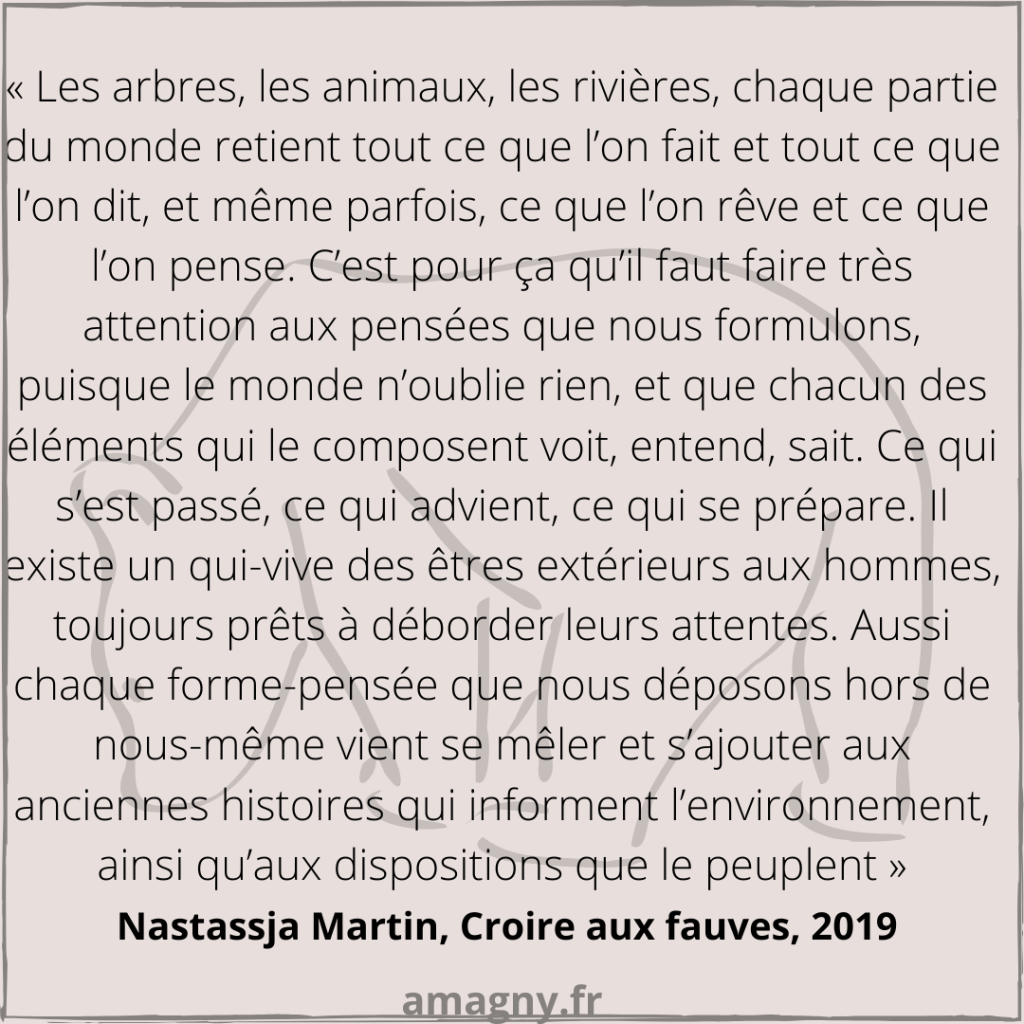
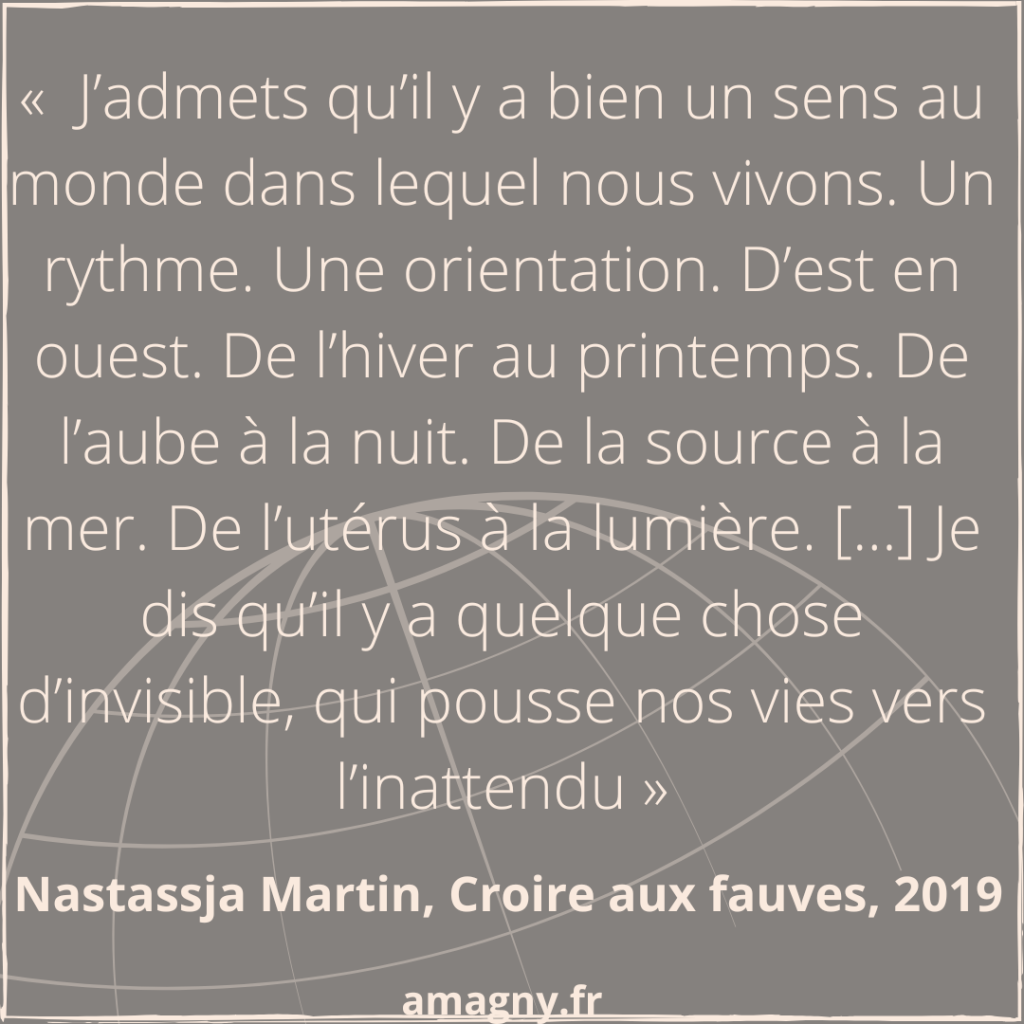
Référence:
Croire aux fauves de Nastassja Martin, Babileo (2019)
Images:




Laisser un commentaire